2. Le catholicisme : identité religieuse
favorisée
Une déclaration du Directeur de cabinet Adjoint du
Ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la
sécurité précise que :
« L'État ivoirien est non confessionnel. Il ne
professe aucune foi,
n'adhère à aucune religion, ne donne investiture et
privilège particulier
à aucune communauté de croyance
»5rapporté par (Dan, 2020, p. 212).
À partir de cette déclaration, la Côte
d'Ivoire semble être présentée comme un pays laïque
dans lequel l'État reconnait une réalité
pluriconfessionnelle. Or Tiémoko Coulibaly (1995, p. 144) affirme de son
côté que : « ...sous le long règne
d'Houphouët-Boigny, la République a tout particulièrement
été investie par la religion du Prince, le catholicisme, alors
que l'islam est officiellement la première religion du pays par le
nombre de ses fidèles.» De ce fait, certains considèrent que
les dignitaires de la religion islamique se comportent comme « des chefs
d'une communauté minoritaire, qui recherchent les bonnes grâces du
pouvoir politique » (CADN, 1963, p. 22 cité par Simonet, 2010, p.
409). Mais le pouvoir politique semble avoir accordé une large place
à la croyance catholique. Certaines actions montreraient ce sentiment de
différence établi entre la religion catholique et la religion
musulmane. « Houphouët dit aux arabisants qu'ils n'entraient pas en
ligne de compte dans les projets de développement ivoiriens »
(Miran-Guyon & Touré, 2012, p. 13). Ainsi on trouve, dans les
manuels scolaires de géographie, des éléments qui
témoignent de l'affirmation d'une croyance religieuse
particulière, catholique, dans la structuration de l'identité
ivoirienne. Par ailleurs, Marie Miran-Guyon (2013, p. 5) affirme qu'en histoire
: « les manuels parlaient d'islam en des termes plutôt
défavorables à cette religion, dépeinte sous l'angle des
djihads et de la violence. » Si dans les manuels d'Histoire, il est
développée l'image dépréciative de l'Islam. Dans le
manuel de géographie en abordant la diversité religieuse de
l'Afrique où la Côte d'Ivoire est présentée comme un
pays catholique. La stratégie d'enseignement était d'occulter
officiellement toute idée d'une identité religieuse sur les
leçons portant sur la Côte d'Ivoire. Mais, paradoxalement sur une
leçon portant sur la population de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est
affichée comme un pays catholique. Comme cela est présenté
sur la figure suivante :
5 Rapport de la conférence sur Religions et
Droits Humains : Thème « la laïcité de l'Etat de
Côte d'Ivoire », Allocution de Monsieur le Directeur de Cabinet
Adjoint du Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de la
sécurité.
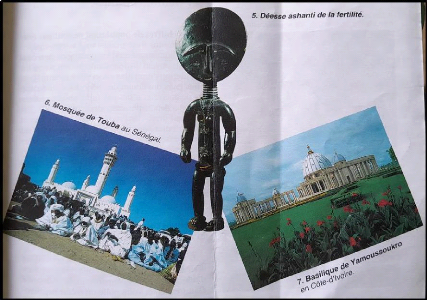
57
Figure 15 : extrait de la page 23 du manuel de
5ème, Hatier/CDEDA, Hors collection
Ce faisant, la Côte d'Ivoire semble ainsi
attachée à une identité religieuse catholique,
malgré sa diversité ethnique et religieuse. C'est pourquoi Marie
Nathalie Leblanc écrit que « Tout récemment la Côte
d'Ivoire était perçue comme un pays catholique, bien que dans les
faits cette identité religieuse soit un plutôt un construit
politique qu'une réalité démographique. Cette construction
politique découle de l'affiliation religieuse du premier
Président de la république Félix Houphouët Boigny,
des liens privilégiés maintenus avec la France et de la
construction de la basilique de Yamoussoukro dans les années 1980 »
(Leblanc, 2003 rapporté par Dan, 2020, p. 212?213). Il pensait sans
doute qu'avec les moyens financiers mis à la disposition de
l'église catholique, les Ivoiriens finiront par l'accepter comme la
religion officielle ivoirienne. C'est pour cette raison Thierry Dan (2020, p.
212) affirme que : « Dans l'imaginaire sociale, le rapport du
président Félix Houphouët Boigny à la religion
chrétienne catholique donne à croire que la Côte d'Ivoire
était vue comme un pays catholique.
Par la construction de la basilique, il s'agit de rendre
visible une identité religieuse catholique qui est minoritaire dans le
paysage ivoirien. Le catholicisme est une religion minoritaire en Côte
d'Ivoire. Comme le disait Marie Miran-Guyon (2013, p. 5) : « fortement
minoritaire auprès de la population. » Donc, l'omniprésence
des paysages de la basilique et du cathédrale Saint-Jean dans les
manuels scolaires de géographie ne reflète pas la
réalité de la société ivoirienne. Il reflète
plutôt l'idéologie religieuse et culturelle que les auteurs
souhaitent faire adhérer la
58
population ivoirienne. La présence récurrente
des iconographiques religieuses catholiques dans les manuels parait garantir sa
bonne promotion auprès des élèves. Par ailleurs, entre
1987 et 2002, la question de la laïcité et la place des musulmans
dans la société est devenue une question vive (Miran-Guyon, 2013)
ou une question socialement vive. Car certains dignitaires musulmans ont
critiqué cette posture étatique de la laïcité en
Côte d'Ivoire.
Dans les années 1980, Houphouët bloqua
d'importants transferts de fonds en provenance de la Banque islamique de
développement et retarda jusqu'en 1993, l'ouverture de relations
diplomatiques officielles avec l'Arabie Saoudite (Miran-Guyon, 2013). Nombreux
sont les musulmans qui se sentirent marginalisés pour des raisons
ethno-politique. Le processus qui présente la Côte d'Ivoire comme
un pays catholique au niveau continental, se retrouve dans l'étude de
l'Europe dès lors que la Pologne est mobilisée pour
présenter l'Europe comme un continent catholique, le continent de
référence de toutes civilisations modernes aux africains. La
figuration du pape, emblématique de la communauté catholique, a
été utilisée à cette fin dans des sections
présentant les caractéristiques économiques de la Pologne,
sans pour autant que le lien ne soit établi (cf. Photographie)
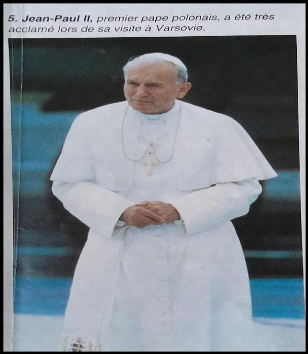
Figure 16 : extrait de la page 125 du manuel de
4ème, Hatier/Ceda, Hors collection, 1994
59
| 


