4.2. Identité exclusive de la région du Nord
dans le développement de l'activité touristique
Dès la première décennie après
l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la politique touristique s'est
affirmée à partir du plan quinquennal de développement
touristique. Alors, les autorités vont créer un Ministère
d'État du tourisme qui aura des structures techniques (SIETHO, ICTA)
pour piloter ses projets entre 1988 et 1990 (Aphing-Kouassi, 2001, p. 7;
Kouadio et al., 2019, p. 321). L'État va mettre en place deux
modèles de développement touristique : la promotion du tourisme
balnéaire dans les villes côtières (San Pédro,
Grand-Bassam et Jacqueville...) et celui du tourisme de découverte dans
les villes de l'intérieur (Degui et al., 2019, p. 284). Pour atteindre
ces objectifs dès 1992, les gouvernements successifs vont se lancer dans
plusieurs programmes de relance de l'activité touristique. Pour diffuser
sa seconde vision de développement, les autorités ivoiriennes
vont faire la promotion de l'activité touristique à travers les
manuels scolaires. Pour illustrer les connaissances sur le tourisme ivoirien
dans les manuels scolaires, les paysages identitaires sont utilisés pour
cela. Ces paysages identitaires sont polarisés sur les paysages de la
population du Sud. À cet effet, la contribution de la population Nord
est exclue dans le développement de l'activité touristique.
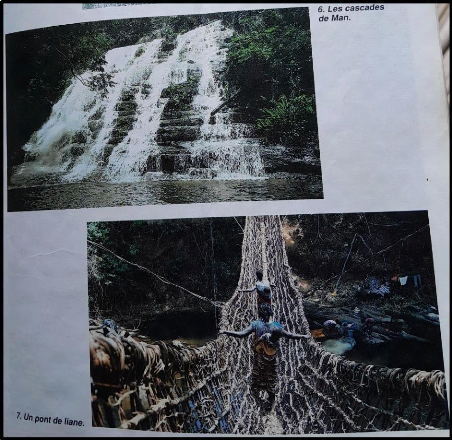
71
Figure 23 : extrait de la page 112 du manuel de
3ème, Hatier/CEDA, Hors collection, 1994
Ces paysages sont des identités culturelles des yacouba
un groupe ethnique de l'aire culturelle Mandé sud installé
à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les paysages identitaires des
populations du Nord sont invisibles dans les manuels comme des atouts
touristiques pour amorcer le développement économique. Pourtant
dans la région Nord, on peut citer le mont Korhogo, les tisserands de
waraniéné, la case aux fétiches de Niofouin, les scupteurs
du quartier Kôkô, les roches sacrées de Shien low, les
collines jumelles de Boundiali et les nombreuses mosquées centenaires
(Kong, Tengrela, Kouto, Nambira) qui sont toutes inscrites au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Aucun.e élève interviewé.e ne sait
dans quelle ville du Nord ces mosquées centenaires inscrites au
patrimoine mondial de l'UNESCO se trouvent-elles.
72
En plus, les autorités vont utiliser dans les manuels un
haut lieu historique dans la ville de Grand Bassam qui est la première
capitale de la Côte d'Ivoire, située dans la région Sud.
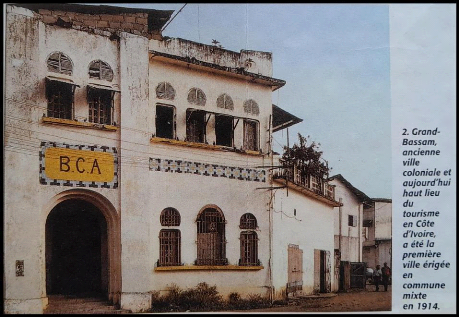
Figure 24 : extrait de la page 91 du manuel de 4ème,
Hatier/CEDA, L'Afrique et le monde, 2002
Ce haut lieu bien que n'étant pas naturel, est un
paysage identitaire de la population du Sud plus particulièrement du
groupe ethnique N'zima. Ces paysages identitaires coloniaux ont permis à
la ville de Grand-Bassam d'être inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO tout comme la mosquée de Kong. Mais, celle-ci n'y figure pas
dans les manuels scolaires. Cet état de fait construit chez les
apprenants un sentiment d'exclusion et de dépendance de la population
Nord.
Par ailleurs, l'iconographie que les auteurs des manuels
doivent utiliser tel un attrait touristique de la population Nord, est
utilisée pour illustrer une activité désorganisée,
dévalorisante qui développe une économie souterraine,
c'est-à-dire une activité informelle.
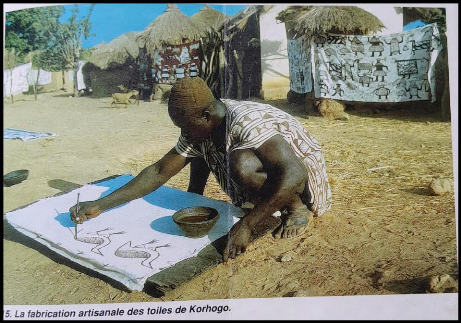
73
Figure 25 : extrait de la page 105 du manuel de 3ème,
Hatier/CEDA, Hors collection, 1994
Cette activité pittoresque de la population Nord attire
des milliers de touristes. Elle est une des identités du peuple
Sénoufo. Le Sénoufo peint son histoire sur ces toiles,
c'est-à-dire, elle retrace sa culturelle immatérielle et
matérielle. Le marché pittoresque de la région Nord est un
attrait à fort potentialité touristique. Mais, paradoxalement,
cette image est utilisée dans un contexte qui la dénude de sa
capacité touristique en la mettant dans une situation
dévalorisante. Dans ce cas, chez les élèves
l'identité de la population Nord comme activité contribue qu'au
niveau secondaire au développement de l'économie du pays. Le
contenu des manuels scolaires conditionne les élèves à
ceux qu'ils doivent aimer ou haïr, à ceux qu'ils doivent
s'identifier ou se différencier.
Même quand les auteurs décident d'utiliser un
paysage du Nord comme un attrait touristique. Le Parc National du Comoé
un paysage patrimonial est un attrait touristique. Ce paysage est
illustré de manière ambigüe comme nous pouvons le voir sur
la figure suivante.
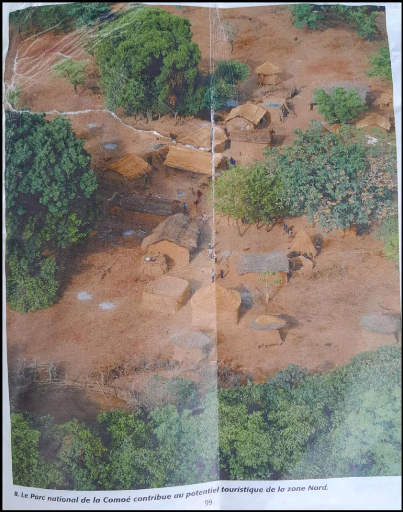
74
Figure 26 : extrait de la page 99, du manuel de 4ème,
Hatier/CEDA, L'Afrique et le monde, 2002
Comment un élève peut-il percevoir la
capacité touristique d'un parc de faune et de la flore illustrer de
cette manière ?
Un parc est un espace protégé et interdit.
Bizarrement, ce parc est pris en image avec presqu'un village à
l'intérieur. En outre, la capacité touristique d'un parc s'est
les espèces animales et végétales que ce parc abrite,
pourtant ce parc est utilisé dans les manuels sans aucune espèce
animale. Ce paysage du parc de la Comoé illustré dans les manuels
scolaires lui faire perdre sa valeur touristique aux yeux des
élèves.
75
| 


