2.1. La notion de culture dans cette étude
Les questions identitaires sont liées à la
question de la culture. La culture se voit partout ainsi il y a de
l'identité pour tous (Cuche, 2016). La culture permet au
géographe de comprend le territoire, de le lire et de déceler ce
qui s'y « passe ». En effet, elle fournit aux hommes les
17
moyens d'organiser leur espace. C'est un canal qui permet de
marquer la différence entre les ethnies. « Le concept de culture en
tant qu'instrument de structuration des communautés, déterminant
autant les conditions d'appartenance au groupe que les différences entre
les groupes » (Bonnemaison et al., 2000, p. 54). La culture est à
la fois un lien et une borne. D'abord, elle rassemble tous ceux qui ont le
même sentiment d'appartenance et elle fait preuve de borne, lorsqu'elle
est utilisée pour marquer la différence entre deux groupes de
sentiment d'appartenance différent. Ensuite, dans une vision pas
toujours saine, elle peut être utilisée pour permettre à un
groupe de dominer un autre groupe ou d'être sous son emprise. Par
ailleurs, il faut savoir que toutes les cultures se valent. Chaque culture
renferme une croyance et une moralité. Elle n'est pas le fruit du
hasard. Elle se construit dans le paysage ou sur le territoire. C'est tout ce
qui n'est pas inné chez l'homme (Claval & Staszak, 2008). Chaque
communauté a une culture qui la singularise des autres
communautés. En un mot, la culture permet la construction
d'identité collective. « La culturelle est l'âme d'un peuple
» (Bonnemaison et al., 2000, p. 84). Selon Sauer la culture, dans son
acception très large, c'est l'ensemble de l'expérience humaine,
spirituelle, intellectuelle et matérielle (idem). Les problèmes
culturels sont abordés par le paysage. Pour essayer de comprendre le
sens du paysage, c'est le point de vue culturel (Berque, 1984).
2.2. Le concept de paysage en géographie
culturelle
L'intérêt pour le paysage commence avec le
développement de la géographie régionale et de
l'étude des genres de vie (Paquette et al., 2005). C'était une
géographie naturelle qui s'intéressait à la
végétation, c'est-à-dire aux différentes formes du
paysage et à la répartition du paysage en fonction des types de
sols. Cette approche naturaliste va s'élargir en intégrant une
approche environnementaliste (le relief, le climat...). Ce milieu naturel est
constitué de ressources. La géographie va s'intéresser
aussi à l'étude de l'exploitation de ces ressources par l'homme.
De ce fait, le paysage va être délaissé au profil de la
région économique. C'est avec l'émergence de la
géographie culturelle, que la réflexion sera menée autour
du territoire (Paquette et al., 2005). La géographie culturelle comme
l'étude du sens (global et unitaire) qu'une société donne
à sa relation à l'espace et à la nature : relation que le
paysage exprime concrètement (Berque, 1984). En géographie
culturelle, le paysage est un espace vécu. La dimension culturelle
s'inscrit dans la matérialité et l'immatérialité du
territoire. Ces deux dimensions interagissent pour donner un aspect singulier
au territoire. C'est cet aspect particulier du territoire qui est le paysage
culturel. Le paysage culturel résulte de la synthèse
18
des facteurs naturels, socio-économiques et culturels
(figure 3). Selon Carl Sauer, un passage naturel devient avec le temps un
passage culturel à cause de la mobilité démographique, de
la densité de population, de l'habitat, de la production et de la
communication (Sanguin, 1984).
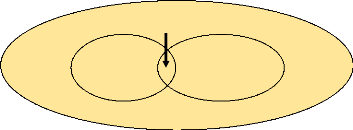
Natural Setting
Cultural
Time
Human
Intervention
Figure 3 : Le paysage culturel comme une constante
interaction entre l'intervention humaine et le milieu naturel
(O'Hare,1997. p.34 cité El Fasskaoui, 2014)
Le paysage culturel est le milieu naturel qui est
marqué par l'intervention humaine. Il nait des interactions des
éléments d'ordre social et des éléments naturels.
Ainsi, à travers le paysage culturel se voit une corrélation
entre la nature et la culture. Selon Brahim El Fasskaoui (2014, p. 34) la
définition du paysage culturel est donnée pour la première
fois en 1925 par Carl Sauer le père de la géographie culturelle
américaine : « The cultural landscape is fashioned from the natural
landscape by cultural group. Culture is the agent, the natural areas is the
medium, the cultural landscape is the result ». De ce fait, le paysage
culturel est à la fois un espace social, culturel et naturel. Le
triangle du paysage culturel se construit à travers ces trois
espaces.
CULTURE
(Savoir, Savoir-être, Savoir-faire ancestraux)
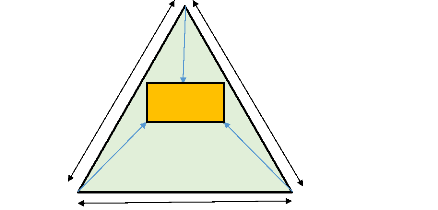
PAYSAGE
HOMME
(Sol, Terre, végétation...)
Paysage culturel
Figure 4 : Le triangle du paysage culturel
19
L'homme se sert du paysage naturel comme support pour
transmettre des savoirs, savoir-être et des savoir- faire ancestraux
(culture). Autrement dit, il utilise le paysage pour mettre en scène des
valeurs culturelles. Le lien culturel formé avec la coïncidence de
la culture et la nature est le paysage. L'homme construit le paysage, ainsi, il
le fait en fonction de son appartenance socioculturelle. Selon le
géographe américain John Brinckerhoff Jackson,
le paysage est « une succession de traces, d'empreintes qui se
superposent sur le sol. Il est, en ce sens, comme une oeuvre d'art ; la terre,
le sol, la nature sont les matériaux que les hommes mettent en forme
selon des valeurs culturelles qui sont différentes dans le temps et dans
l'espace » citée par (Domingues, 2006). Et ce paysage culturel
n'est pas figé. Il se développe avec les aspirations de la
communauté qui le crée. Le paysage résulte de la
construction sociale et culturelle. Les mosquées centenaires du type
soudanais dans le paysage de la région du Nord mettent en scène
les valeurs culturelles religieuses islamiques de la population. La
construction du paysage relève l'identité de la communauté
qui l'a construit. Le paysage a une valeur identitaire quant-il désigne
à la fois un seul territoire et un seul groupe social (Sgard, 1997). Ce
paysage est objet d'unité de ce groupe social et fait sa
particularité. De ce fait, le groupe social dégage un sentiment
d'attachement à ce paysage. Dès lors, on parlera de paysage
identitaire. Comme c'est le cas avec les ponts de liane dans les paysages des
ethnies Yacouba, la construction de ces paysages résultent d'un
savoir-faire socio-culturel. Le paysage identitaire permet à une
communauté de s'identifier à une culture, à une
société, de se situer dans le temps et dans l'espace. Le paysage
est la porte d'entrée pour comprendre les liens tissés entre la
communauté et leur territoire. Les poissons sacrés permettent de
comprendre le lien que puisse plusieurs ethnies avec leur espace. Il y a une
codification du paysage dans un système de valeurs par la
société. Ainsi, Anne Sgard (1997) attribué trois grands
types de valeurs au paysage : une valeur marchande, une valeur patrimoniale et
une valeur identitaire. On peut aussi faire une catégorisation du
paysage : paysage-cadre de vie ; paysage-identité ; paysage-ressource et
paysage-patrimoine (Bonnemaison et al., 2000). Le paysage identitaire est le
fait qu'une société dégage un sentiment d'appartenance
à une espèce naturelle (haut-lieu, végétation,
eau...) ou à une oeuvre humaine particulière et
emblématique. L'identité de la communauté s'exprime
à travers cet élément naturel ou humain. Cet
élément peut être sacré ou non. Il est un objet
culturel, car en dehors du paysage, il n'y a pas de culture. Dans la
région du Nord, les roches sacrées de Shien low sont les objets
culturels de cette communauté.
Le paysage identitaire peut être aussi un objet de
marketing territorial. Dans la promotion du tourisme, il peut être
utilisé comme un logo (Sgard, 1997). On parlera de
l'instrumentalisation
20
de l'identité territoriale au service de
l'attractivité touristique (Bayed & Sedra, 2020). En Côte
d'Ivoire, on peut citer le pont de liane et la basilique notre dame de
Yamoussoukro. À cet effet, un paysage peut avoir à la fois une
fonction identitaire et une fonction marchande avec la caution de la
communauté, qu'il représente. Cependant, il n'y a pas lieu de
confondre un logo publicitaire qui a uniquement une valeur monétaire
à un paysage identitaire (Sgard, 1997).
Le paysage identitaire peut être aussi encore un lieu
patrimonial. Ce paysage qui résulte de la mémoire collective peut
être menacé de disparaitre pour cela les actions politiques seront
entreprises pour l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il sera
protégé et préservé. Ainsi, le paysage identitaire
se trouve être un patrimoine socio-culturel. Je pense à la
mosquée centenaire de Kong qui a été construite en terre
à l'époque soudanais, c'est-à-dire au XVIIème
siècle. Ici, il ne faudrait pas confondre un paysage patrimonial tout
court à un paysage identitaire. À titre d'exemple comme paysage
patrimonial, je peux citer le parc national de Taï qui est inscrit au
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, n'est pas pour autant un paysage
identitaire.
Voilà défini le paysage identitaire, il a une
fonction interne et une fonction externe selon (Sgard, 1997). La fonction
interne, c'est le rôle que joue le paysage auprès du groupe
social. C'est la relation que tisse le groupe social avec le paysage. Quant
à la fonction externe, c'est l'image que le groupe social veut donner de
lui à l'extérieur.
| 


