CHAPITRE III :
PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS
Cette partie est consacrée, d'une manière
générale, à l'enquête et à la conception de
notre outil méthodologique. Concernant l'enquête dont les outils
et techniques ont déjà été exposés, il est
question d'identifier les sujets enquêtés (1) de présenter
et d'analyser les résultats de ladite enquête (2). Le dernier
point (3) s'occupera de la conception de notre instrument
méthodologique.
3.1.
Identification des sujets enquêtes
Les établissements ayant réellement fait l'objet
de notre étude sont de types et des ordres présentés dans
le cadre méthodologique, et plus précisément dans les
populations cible et accessible : les établissements de la sous-division
Kikwit 1 de la province éducationnelle Kwilu 2 (www.new.secoperdc.com)
consignés dans le tableau ci-après :
Etablissements publics et privés
|
Etablissements
Privés
confessionnels
|
Etablissements privé laïcs
|
Etablissements Publics de l'Etat
|
|
Type
|
Nom
|
Type
|
Nom
|
Type
|
Nom
|
|
Général
|
Collège ST FR TIMOTHE
|
Général
|
C.S BANATE
|
Technique
|
ITAV
|
|
général
|
Lycée YEDISA
|
Général
|
IDAP/ISP-KKT
|
Technique
|
Institut KANGULUMA
|
|
général
|
C.S Marie Martine
|
|
|
Général
|
Institut 2 LUKOLELA
|
|
Général
|
Wemboniama
|
|
|
Général
|
Institut 1 NGEMBA
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 16 : Identification des sujets
enquêtés
3.2.
Présentation et analyse des résultats28
Les résultats d'enquête nous permettront non
seulement (1) de répertorier les démarches d'intégration
des différents établissements enquêtés, mais aussi
(2) de déterminer les paramètres de décision devant nous
conduire à la conception de notre dispositif.
3.2.1. Les
stratégies répertoriées
L'analyse des pratiques d'intégration des TIC
observées sur le terrain exige (1) une analyse statistique
préalable conduisant à la détermination des
démarches des différents établissements, (2) une
synthèse de ces démarches en lignes stratégiques et en fin
(3) une analyse SWOT de celles-ci comme base de la détermination des
variables décisives de la conception de notre outil.
28Tshimpaka,
Appropriation des artefacts numériques à
Kinshasa selon un modèle environnemental, Étude 2021
P.67
3.2.1.1. Présentation et
analyse statistique préalable
A la lumière du questionnaire élaboré
à cet effet, les résultats de l'enquête seront
présentés et statistiquement analysés immédiatement
suivant les sept groupes de questions qui déterminent les axes
stratégiques choisis. Dans cet examen nous nous sommes destinés
à ressortir les groupes d'établissements formulant dans une large
mesure, la même démarche, puis jeter tout de même un
léger regard à la tendance de chaque ordre d'enseignement en
statuant sur la tendance générale pour comprendre
l'intégration des TIC dans sa globalité
Groupe de questions N°1 : De la
Coordination, mobilisation et information
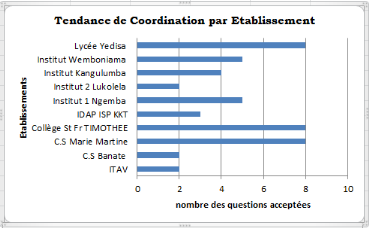
Figure 8: Tendance de Coordination par
établissement
Ce dernier diagramme de la coordination montre que les
établissements privés laïcs et publics manquent d'une
manière générale de coordination ; tandis que les
écoles privées confessionnelles ont une forte tendance à
la coordination, mobilisation et l'information des acteurs du système
école pour le projet d'intégration des TIC à
l'école.
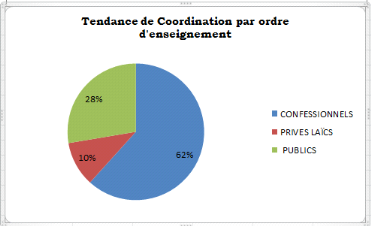
|
Figure 9 : Tendance de coordination par
ordre
d'enseignement
|
|
Groupe de questions N°2 : Actions
prioritaires incluses dans le plan
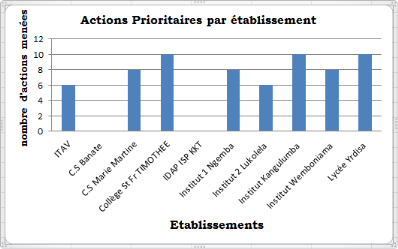
La distribution des actions prioritaires indique trois types
de démarches : un premier groupe d'établissements (ITAV et
Institut 2 Lukolela) qui a mis en oeuvre six actions sur les dix ; un
deuxième groupe à prédominance d'actions manquées
(C.S Banate et IDAP/ISP)
Figure 10 : Niveau d'engagement d'actions prioritaires
par établissement
Le dernier groupe ayant deux sous-groupes dont le premier,
ensemble d'établissements ayant engagé toutes les actions
prioritaires (Kangulumba, Collège St Fr TIMOTHEE et Lycée
Yedisa), et le deuxième sous-groupe présentant huit actions sur
les dix (C.S Marie Martine, Ngemba 1 et Wemboniama).
Mais la tendance générale stipule que 63% des
actions prioritaires ont été engagées par les
établissements du troisième groupe (Kangulumba, Collège St
Fr TIMOTHEE,Lycée Yedisa et C.S Marie Martine, Ngemba 1 et
Wemboniama).
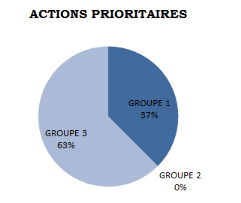
. Ces actions concernant beaucoup plus l'implantation des TIC
prouvent la volonté et une forte propension des établissements
à acquérir ces technologies.
Figure 11 : Degré des actions prioritaires
incluses dans le plan
En conclusion sur la planification de l'intégration des
TIC dans l'enseignement, il se dégage trois démarches : la
première est sans planification aucune (Institut 2 Lukolela, ITAV
,Institut Banate et IDAP/ISP), le deuxième avec une planification
délocalisée (C.S Marie Martine, Institut Wemboniama et Institut 1
Ngemba) et le troisième une planification exemplaire (Collège St
Fr TIMOTHEE, Institut Kangulumba et Lycée Yedisa).
Groupe de questions N°3 :
Infrastructures et technologies
L'autonomie infrastructurelle et
technologique témoigne généralement du
pouvoir financier d'une structure. Le diagramme de
répartition dénote deux groupes d'établissements dont un
à prédominance déficitaire (Institut 2 Lukolela, ITAV,
IDAP/ISP) et le second (Le Collège St Fr TIMOTHEE, Institut Kangulumba,
Lycée Yedisa, C.S Marie Martine, Institut Wemboniama et Institut 1
Ngemba) présentant plutôt un nombre élevé
d'infrastructures sur les six retenues.
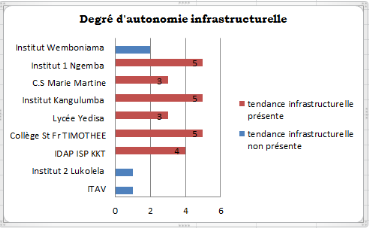
Figure 12 : Tendance à l'autonomie
infrastructurelle par établissement
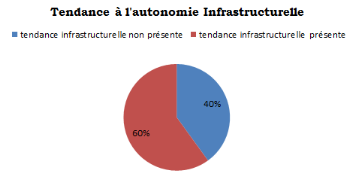
Nous pouvons noter ici que l'autonomie financière ne
garantit pas totalement l'intégration des TIC dans les normes
stratégiques. Car voilà un exemple de l'institut 2 Lukolela qui
présentent un certain degré d'autonomie financière (et/ou
infrastructurelle), mais dont l'intégration des TIC reste boiteuse. Ce
qui confirme encore la nécessité d'élaboration d'une
stratégie sur un projet aussi bien conçu.
Figure 13 : Degré d'autonomie
infrastructurelle
La tendance générale des infrastructures
souligne que 60% des infrastructures sont présentes dans les
établissements enquêtés. Ce qui est au-dessus de la
moyenne. Mais cela ne signifie pas que le reste des infrastructures soient
négligeables ; car chacune d'elle devant jouer un rôle que
d'autres ne peuvent assurer.
La tendance générale de cette autonomie, comme
le montre le diagramme ci-contre, présente les établissements
publics à un niveau infrastructurel et technologique plus bas que celui
des établissements privés.
Groupe de questions N°4 :
Matériel et équipements
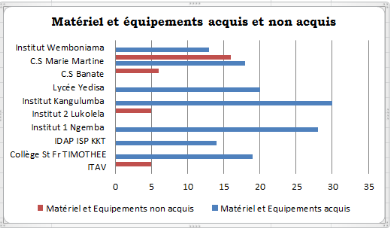
La répartition du matériel acquis et non acquis
par les établissements les subdivise en deux groupes. Le premier est
constitué des établissements présentant un manque criard
d'équipements (Institut 2 Lukolela, ITAV, IDAP/ISP, C.S Banate) et le
deuxième au niveau très élevé d'équipements
second (Le Collège St Fr TIMOTHEE, Institut Kangulumba, Lycée
Yedisa, et Institut 1 Ngemba).
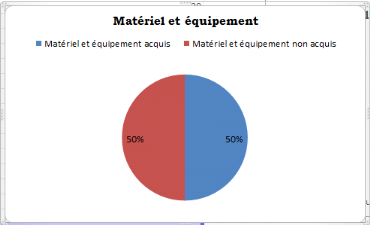
Figure 14 : Acquisition du matériel par
établissement
Figure 15: Répartition du nombre de
matériel et équipements par établissement
La part du matériel et équipement dans les
établissements montre que ceux-ci ont acquis 50% du matériel et
des équipements retenus. Étant donné que près de la
moitié du matériel est encore à acquérir, ce qui
signifie que les problèmes liés à cet ordre de besoin se
feront ressentir. Mais en nombre d'équipement le collège Institut
Kanguluma se trouve en tête selon la répartition du nombre
d'équipements du diagramme ci-haut.
Quant à la répartition des équipements,
pas en nombre mais en présence dans les établissements,
concernant leur ordre, les écoles privés confessionnelles
dominent (3 établissements sur 4) sur les écoles publiques et
privées laïques (2 établissements sur 6).
Sous-groupe N°4.1 : Ordinateurs
de la salle des machines et du CRM (laboratoires pédagogiques)
Concernant les salles d'informatiques, nous constatons trois
grands groupes : un premier dont les salles d'informatiques contiennent une
quinzaine d'ordinateurs, un deuxième dont le nombre d'ordinateurs est
supérieur à 35 et un dernier qui n'a aucune salle d'informatique
pour les enseignements de l'informatique en tant que matière.
Dans le cas des CRM ou laboratoires pédagogiques seul
les deux instituts, Institut 1 Ngemba et Institut Kanguluma sont bien fournis,
à côté desquels se trouve le Collège Bodika qui
possède un nombre d'ordinateurs même restreint,
dédiés à des laboratoires pédagogiques.
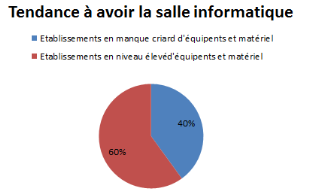
En revanche la tendance générale montre que la
majorité des établissements (60% soit 6 écoles niveau
élevé d'équipement sur 10 écoles) possèdent
une salle informatique et 40% (soit 4 écoles sur 10) seulement, un
centre multimédia. Ce qui témoigne que l'intégration des
TIC dans notre pays est encore en phase d'implantation : se livrer à
l'acquisition du matériel et équipements.
Figure 16 : Etablissements ayant une salle
informatique
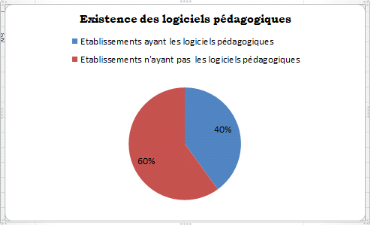
Sous-groupe N°4.2 : Logiciels
pédagogiques
Figure 17 : Existence des logiciels
pédagogiques
L'acquisition des logiciels pédagogiques, selon la
répartition par établissement, présente seulement 4
établissements sur dix qui se sont lancés dans leur acquisition
(Institut 1 Ngemba, Institut Kangulumba, Collège St Fr TIMOTHEEet
Lycée YEDISA). Ce qui signifie qu'ils sont les seuls ayant
expérimenté l'enseignement avec les TIC.
Mais la tendance générale présente une
majorité d'établissements (60%) qui ne sont encore qu'à la
phase d'implantation des TIC.
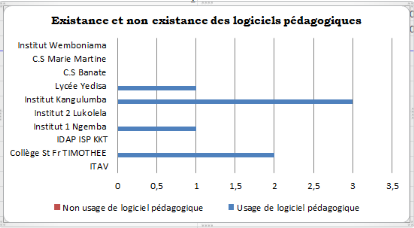
Figure 17 : Etablissements ayant de logiciels
pédagogiques
Groupe de question N°5 :
Ressources humaines et leadership
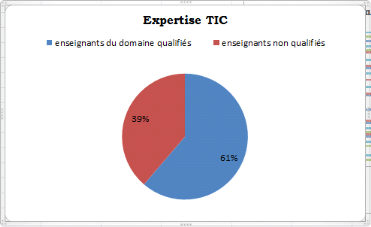
Sous-groupe N°5.1 : Expertise
TIC
Figure 18 : Répartition générale
de l'expertise TIC
L'expertise en TIC montre une forte prédominance de la
formation spéciale. Ce qui signifie que l'informatique est comparable
à de l'opium dans notre milieu. Car tous les profils s'y sont vite
lancés pour un monitorat ou alors pour l'enseignement de la discipline.
Sa tendance générale présente donc jusqu'à 61% du
personnel enseignant qualifié d'informatique des établissements.
Et 39% du personnel enseignant non qualifiés. La qualité de
l'expertise (L2 classique) se fait ressentir à 22,6% soit 7 enseignants
sur 31; ce qui reste très insuffisant. Le parcours général
de cette expertise présente le besoin de formation aux TIC et à
la conception, la planification stratégique des projets
d'intégration des TIC dans l'enseignement.
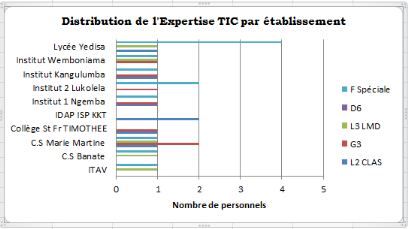
Figure 19 : Expertise TIC/TICE par
établissement
Groupe de question N°6 :
Problèmes rencontrés lors de la mise en oeuvre du plan
Dans le tableau récapitulant les problèmes par
établissement, nous avons regroupé les écoles
présentant les mêmes problèmes pour que celles-ci soient
aussi analysées conjointement.
Tableau 19 : Problèmes rencontrés par
établissement
|
Problèmes rencontrés
|
Problèmes rencontrés
|
Etablissement
|
|
|
Difficile adhésion des acteurs
Pas de salle à allouer aux équipements,
Récupération négative de certains acteurs sur le projet
TIC
|
Difficile renouvellement des machines, Certains utilisateurs
gâtent facilement les ordinateurs
|
Institut 2 Lukolela et ITAV
|
|
Difficile adhésion des acteurs
Récupération négative de certains acteurs
sur le projet TIC
On ne maîtrisait plus rien par moment
|
Difficile renouvellement des machines Les ordinateurs
s'amortissent
rapidement
Incompatibilité de certains équipements
|
C.S Marie Martine
et
Wemboniama
|
|
Difficile adhésion des acteurs
Pas de salle à allouer aux équipements Certaines
actions ont eu un retard
|
Récupération négative de certains acteurs
sur le projet TIC
Certains utilisateurs gâtent facilement les ordinateurs
|
Collège St Fr TIMOTHEE
|
|
· Pas de salle à allouer aux équipements
|
Incompatibilité de certains équipements
|
IDAP ISP et C.S Banate
|
|
· Pas de salle à allouer aux équipements
· Difficile renouvellement des machines
|
Les ordinateurs s'amortissent rapidement
|
Lycée YEDISA
|
|
· Récupération négative de certains
acteurs sur le projet TIC
|
Difficile adhésion des acteurs
|
Institut 1 Ngemba et Institut Kangulumba
|
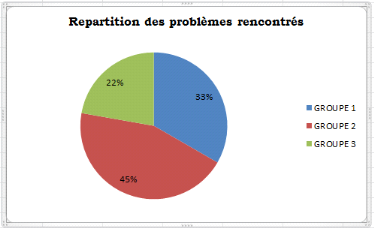
Figure 34 : Répartition des problèmes
rencontrés
La répartition des problèmes par
établissement fait ressortir trois groupes :
· Le premier groupe, constitué du lycée
Yedisa, IDAP ISP, C.S Banate et du Collège St Fr TIMOTHEE, n'a
rencontré presque pas de problèmes lors de la planification
stratégique et la mise en oeuvre du projet d'intégration des TIC
dans leur école. Conformément au tableau d'analyse des
problèmes des établissements, et prenant en compte les analyses
précédentes, il ressort que seul le Collège Bodika n'a
rencontré de problèmes parce qu'avoir bien coordonné et
planifié. Par contre le reste d'établissements, soit, a
amorcé le projet et ce dernier s'est arrêté, soit alors n'a
même jamais formulé de projet.
· Le deuxième groupe comporte les
établissements C.S Marie Martine, Institut Wemboniama et Institut 1
Ngemba et Institut Kangulumba. Conformément aux analyses
précédentes, ces établissements expérimentent
chacun de manière différente l'intégration des TIC dans
l'enseignement.
· Le dernier groupe, le troisième constitué
de l'Institut 2 Lukolela et ITAV, présentent un nombre
élevé de problèmes. L'analyse précédente
nous a montré que ces écoles sont essoufflées parles
problèmes.
Les problèmes les plus récurrents sont
:
Ø La difficulté adhésion des acteurs du
système école, signifiant que l'intégration des TIC, en
tant qu'innovation est très complexe ;
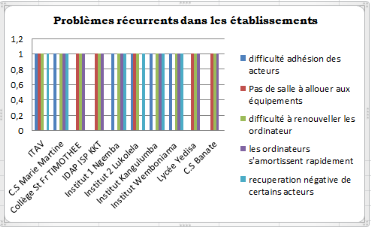
Ø Pas de salle à allouer pour les
équipements des salles informatiques ou multimédias : les
établissements voulant intégrer les TIC dans leur système
doivent d'abord régler les problèmes des infrastructures
logistiques ;
Figure 21 : Problèmes récurrents dans
les établissements
Ø Récupération négative de
certains acteurs : les TIC bousculent les valeurs et pratiques du milieu
scolaire. Ce qui crée alors des résistances ;
Ø Difficile renouvellement des ordinateurs : dans ce
cas, soit un budget de fonctionnement des TIC n'a été mis au
point, soit alors les lourdeurs administratives font blocage ;
Ø Les ordinateurs s'amortissent rapidement : soit le
matériel acquis est de seconde main, soit alors les utilisateurs ne sont
pas suffisamment formés ; les détails par rapport à ces
problèmes sont listés dans le grille d'analyse des
difficultés en annexe.
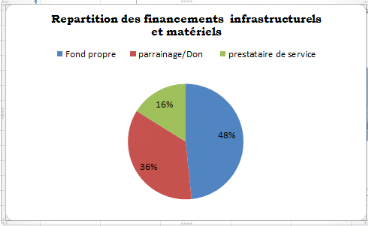 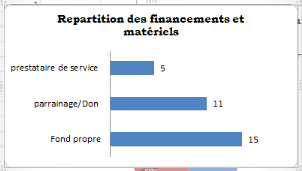
Groupe de question N°7 : Les
moyens d'acquisition du matériel et équipement
Figure 22 : Repartition des financements
infrastructurels et matériels
La répartition des financements du projet ressort 48%
de financement par fonds propres, 36% par parrainage ou mécénat
(don) et seulement 16% par prestataires de services. Ceci prouve que la
sécurité matérielle se repose sur le contrôle total
sur ledit matériel. Ce qui contribue à la réussite dans le
projet.
| 


