Transformations des
représentations de l'agriculture et de la ruralité
Y-a-t-il eu, ces dix dernières années, des
transformations des représentations de l'agriculture et de la
ruralité dans le contexte de la construction du Projet Nô-Life,
dont notamment le vieillissement de la population urbaine et rurale ?
Pour répondre à cette question, nous allons
tenter de simplifier dans un tableau de synthèse les
représentations des sept acteurs que nous venons d'étudier (ce
tableau se trouve à la page suivante). Pour établir ce tableau
nous avons retenu quatre éléments constitutifs des
représentations : contextualisation (constat de la situation) ;
problématisation (problèmes et solutions) ; intention
(motivation) ; intérêt.
Ensuite, nous pouvons distinguer les trois groupes suivants
catégorisant les sept acteurs étudiés : 1 Service public
agricole (BPA, BDPA) ; 2 Secteur agricole (CAT, ECV, GASATA) ; 3 Public en
général (SCI, CLFS) Ces trois groupes montrent trois types
distincts d'évolution des représentations de l'agriculture et de
la ruralité.
1 Service public agricole
Contexte de la restructuration
D'abord, concernant les acteurs du service public agricole,
les accords du GATT eurent une influence décisive de manière
à imposer d'en haut les décisions de la politique internationale
sur le commerce des produits agricoles aux politiques nationale et locale.
Parmi ces accords, la « catégorie verte » dans le
cadre du Soutien interne semble importante dans la mesure où elle a
encadré la restructuration des services publics agricoles. Comme nous
l'avons constaté dans la partie de l'analyse de l'acteur 1, cette
catégorie laissa une place légitime aux services publics
« de caractère général » dans les
domaines concernant la recherche, la lutte contre les maladies, de
l'infrastructure et de la sécurité alimentaire, tout en les
excluant des objets de la « réduction » des mesures
protectrices des Etats membres. C'est dans ce contexte politico-historique que
fut conçu par la Municipalité de Toyota le Plan de 96 qui apporta
une nouvelle direction de la politique agricole dans le territoire de la Ville
de Toyota.
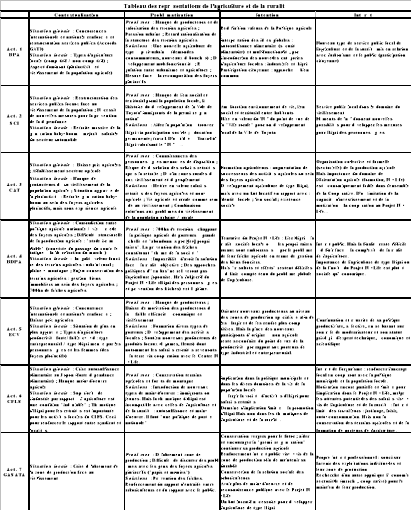
Toutefois, aux yeux des acteurs concernés, cette
restructuration n'est pas seulement le reflet du contexte dicté par la
politque internationale de la libéralisation du marché : Monsieur
M du BDPA a bien souligné l'état
« irrémédiable » de l'agriculture japonaise
suite au passage historique de la politique : de la protection du
marché du riz à la libéralisation de celui-ci. Pour lui,
la position de l'administration est de « [venir] en aide pour
combler cette absence des aides du gouvernement qui étaient mises en
place auparavant », et cet état actuel de
l'administration est qualifié de
« douloureux ». Cette remarque témoigne du
point de vue de Monsieur M, qui est un acteur de l'intérieur de
l'administration locale subissant le contexte de cette restructuration. En
fait, selon lui, la situation de l'administration locale vis-à-vis de
l'agriculture est aujourd'hui comme si elle « traitait un malade
qui est dans un stade irrémédiable »,
c'est-à-dire, l'administration (service public) locale doit payer les
pots cassés de la politique agricole nationale qui était mise en
place auparavant. Mais quels pots cassés ? Nous pouvons rappeller deux
défaillances historiques de la politique agricole japonaise : Selon
Monsieur N, la politique agricole japonaise impliquait une contradiction dans
sa tentative permanente de la modernisation agricole consistant à
favoriser l'aggrandissement d'échelle et la spécialisation au
detriment des conditions de la réalité locale faisant obstacle
à ce type de modernisation (petite structure des exploitations
familiales, zones en plaine subissant la forte pression urbaine, zones en
moyenne montagne condamnée à subir l'exode et le vieillissement
de la population rurale critique etc). Puis, s'y ajoute la politique du soutien
au marché du riz qui a provoqué la surproduction dès les
années 70.
Nous devons resituer la nouvelle politique menée par la
Municipalité de Toyota dans ce contexte paradoxal dans le sens où
cette politique paraît ambitieuse du point de vue du marché, mais
désespérante du point de vue « objectif » de
Monsieur M, un acteur de terrain qui vit et opère par lui-même les
mesures de cette politique au niveau local.
|

